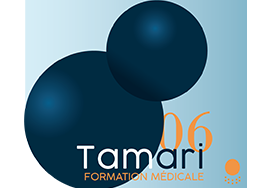FAF_Etat de stress post-traumatique : diagnostic et prise en charge
Les attentats connus en France depuis 2013 et 2015 ont mis en évidence l'impact du stress-post-traumatique chez les victimes, mêmes si elles n'ont pas été blessées physiquement, ou témoins directs ou indirects, menant à un premier constat. (1)
Mais cet état peut survenir à la suite de toute agression. Il est reconnu depuis longtemps que l'état de stress post-traumatique (ESPT) est souvent associé à des troubles somatiques et à un handicap socioprofessionnel entraînant d'importantes conséquences en matière de qualité de vie et de coût de prise en charge financière par la société. La dépression représente le trouble le plus fréquemment associé à l'ESPT avec une comorbidité oscillant entre 30 et 80 % selon les études.
Le trouble de stress post-traumatique déborde le champ du biologique. ?Le traumatisme est un véritable organisateur de la pensée psychiatrique?. Le trouble du stress post-traumatique soulève de nombreuses questions sur le corps, l'image de soi, l'angoisse existentielle, la mort. De ce fait il peut se présenter sous de nombreuses formes. (2)
Le DSM-5 a supprimé ?la réaction émotionnelle subjective au traumatisme? car ce n’est pas un critère de diagnostic, mais il répertorie 4 groupes de symptômes : le groupe évitement /engourdissement divisé en 2 : l’évitement et les altérations négatives persistantes des capacités cognitives et de l’humeur et les épisodes de remémoration (flashback) explicitement décrits comme un symptôme dissociatif. (3)
Le trépied clinique de base de l'Etat de Stress Post Traumatique s'organise autour des réviviscences de l'événement traumatique (?flashbacks? ou cauchemars), du syndrome d'évitement (pouvant conduire à conduire à une isolation sociale et à des difficultés relationnelles) et de troubles d'hyperactivité neurovégétative (réactions de stress accrues, comme l'irritabilité, les troubles du sommeil et l'hypervigilance mais aussi des réactions physiques intenses, comme une tachycardie ou une sudation excessive). (4)
Le médecin peut être amené à recevoir des patients présentant des troubles de la personnalité et comportementaux parfois associés à des troubles psychomoteurs qu’il lui faudra savoir rattacher à leur véritable origine (stress post traumatique) : le repérage et le diagnostic précoce, prenant en compte les populations les plus à risque, les signes d’alerte et les critères diagnostiques les plus pertinents, sont une étape essentielle car le risque de chronicité, de rechute et de désinsertion sociale est notable. Le médecin pourra alors proposer des conduites de prévention efficaces et/ou un traitement, selon le stade d’évolution de ces troubles. (2) (5)
L’objectif général de cette formation est d’apporter aux participants une meilleure connaissance des composantes du stress post traumatique afin de mieux conduire leur questionnement des patients pour aboutir à un diagnostic étayé et dans un deuxième temps de pouvoir mettre en place une prévention et/ou un traitement adapté à chaque patient.
Mais cet état peut survenir à la suite de toute agression. Il est reconnu depuis longtemps que l'état de stress post-traumatique (ESPT) est souvent associé à des troubles somatiques et à un handicap socioprofessionnel entraînant d'importantes conséquences en matière de qualité de vie et de coût de prise en charge financière par la société. La dépression représente le trouble le plus fréquemment associé à l'ESPT avec une comorbidité oscillant entre 30 et 80 % selon les études.
Le trouble de stress post-traumatique déborde le champ du biologique. ?Le traumatisme est un véritable organisateur de la pensée psychiatrique?. Le trouble du stress post-traumatique soulève de nombreuses questions sur le corps, l'image de soi, l'angoisse existentielle, la mort. De ce fait il peut se présenter sous de nombreuses formes. (2)
Le DSM-5 a supprimé ?la réaction émotionnelle subjective au traumatisme? car ce n’est pas un critère de diagnostic, mais il répertorie 4 groupes de symptômes : le groupe évitement /engourdissement divisé en 2 : l’évitement et les altérations négatives persistantes des capacités cognitives et de l’humeur et les épisodes de remémoration (flashback) explicitement décrits comme un symptôme dissociatif. (3)
Le trépied clinique de base de l'Etat de Stress Post Traumatique s'organise autour des réviviscences de l'événement traumatique (?flashbacks? ou cauchemars), du syndrome d'évitement (pouvant conduire à conduire à une isolation sociale et à des difficultés relationnelles) et de troubles d'hyperactivité neurovégétative (réactions de stress accrues, comme l'irritabilité, les troubles du sommeil et l'hypervigilance mais aussi des réactions physiques intenses, comme une tachycardie ou une sudation excessive). (4)
Le médecin peut être amené à recevoir des patients présentant des troubles de la personnalité et comportementaux parfois associés à des troubles psychomoteurs qu’il lui faudra savoir rattacher à leur véritable origine (stress post traumatique) : le repérage et le diagnostic précoce, prenant en compte les populations les plus à risque, les signes d’alerte et les critères diagnostiques les plus pertinents, sont une étape essentielle car le risque de chronicité, de rechute et de désinsertion sociale est notable. Le médecin pourra alors proposer des conduites de prévention efficaces et/ou un traitement, selon le stade d’évolution de ces troubles. (2) (5)
L’objectif général de cette formation est d’apporter aux participants une meilleure connaissance des composantes du stress post traumatique afin de mieux conduire leur questionnement des patients pour aboutir à un diagnostic étayé et dans un deuxième temps de pouvoir mettre en place une prévention et/ou un traitement adapté à chaque patient.
Pour qui?
Généralistes et autres spécialistes